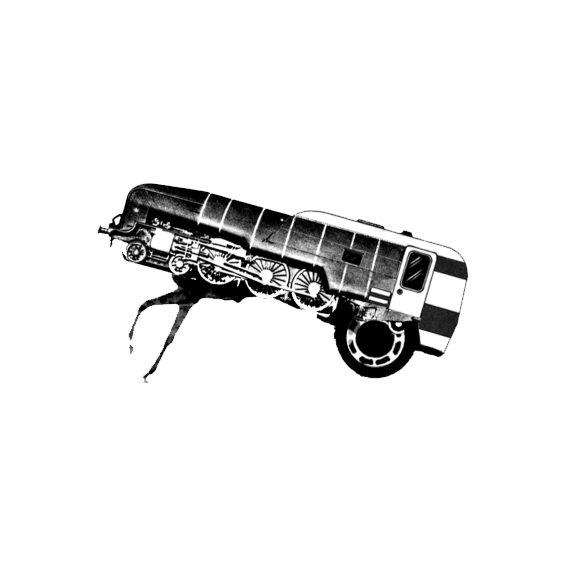menu

« ESPACE MOBILE »
Numéro 4
Intervenant en mai 2012 dans le cadre du doctorat sauvage, Denis Retaillé, géographe, spécialiste des questions de nomadisme, propose de remonter le mécanisme de la spatialisation jusqu'à considérer que l'espace est fondamentalement mobile. Entrevoyant ainsi la spatialité comme beaucoup plus complexe que les propriétés d'étendue et de localisation ne le laissent entendre. Dépassant la rationalité syllogistique faite d'inclusion et d'exclusion. La simplification, base de l'activité cartographique (y compris métaphorique) s'en trouve subvertie. Conçue comme crise, déséquilibre ou irrationalité, cette subversion apparaît au contraire avec l'espace mobile comme la rationalité poussée au paroxysme. C'est de cela qu'il s'agit dans la conférence qui suit, assez mal venu dans la doxa géographique. Et c'est en Afrique sahélienne que Denis Retaillé en a trouvé les indices…
Le nomadisme historique, caravanier et pastoral, a presque totalement disparu au Sahara et dans ses marges. La sédentarisation volontaire ou forcée l’a emportée sans que pour autant soit oublié ce qui permettait la survie : la mobilité. Et pour cause, le mouvement est premier dans la production de l’espace des sociétés, avant le cloisonnement et l’ancrage. Même dans cette configuration appelée territoire, le mouvement est encore nécessaire sans quoi il n’y a tout simplement pas de reproduction possible. C’est le mouvement de l’échange qui n’est pas forcément marchand.
Cette nécessité de la mobilité est masquée par une idéologique spatiale sédentaire, dominante depuis la « révolution néolithique », surtout formalisée avec la naissance de l’Etat et singulièrement l’Etat moderne défini, entre autres, par son territoire et sa frontière. La délimitation est ce geste d’appropriation permettant de fonder la fiction d’une identité collective, qui autorise la confusion avec sa définition. Délimitation comme fondement de la définition, nous sommes là les héritiers directs de la conception aristotélicienne de l’espace et du lieu comme étendue du corps délimité. Alors que le mouvement est nécessaire, voilà que le cloisonne-
ment est devenu le fait premier. Cette inversion permet de masquer ce qui est à l’origine du pouvoir dans les sociétés : rien moins que le contrôle du mouvement.
Le mouvement persiste et le pouvoir est toujours entre les mains de ceux qui le contrôlent. La « mondialisation », souvent présentée comme une nouveauté de la fin du siècle dernier, en réactualise la puissance et rend nécessaire la reprise, à nouveaux frais, de notre représentation de l’espace. Il faut même aller plus loin, c’est la conception de l’espace des sociétés qui est visée, dont nous avons constaté qu’elle était une idée sédentaire pour mieux contrôler le mouvement et justifier le pouvoir. En amont des représentations de l’espace se dessine ce cadre d’autorité qui a permis l’évidente nécessité du cloisonnement et de la sédentarité, un espace de représentation comme disait Henri Lefebvre (1974) qui convient mal au tableau du monde quand la fiction de l’Etat apparaît pour ce qu’elle est.
Chez les nomades récemment disparus, un autre espace de représentation a résisté jusqu’à nos jours, mettant en cause le pouvoir sédentaire par le territoire délimité. Les événements de l’année 2012 abusivement situés au Mali, plus judicieusement au Sahel, nous le signalent par la reconversion des savoirs nomades. Non seulement le mouvement est premier, mais l’espace est lui-même mobile et non pas ancré dans des lieux ou découpé en territoires exclusifs et exhaustifs comme ceux des Etats.
Espace mobile ? L’apposition des deux mots est incompréhensible dans la géographie que nous avons apprise, celle qui s’accroche aux lieux toujours déjà là. Cela tient à l’incontestable efficacité de l’espace sédentaire des représentations. Pourtant, notre géographie « spontanée » a conservé le souvenir de la mobilité nécessaire, l’idée que la distance sépare et que notre vie sociale tient tout entière dans son réglage. Autrement dit, une incohérence perturbe ce que nous vivons (la mobilité) et ce que nous savons ou croyons savoir : que l’identité individuelle ou collective est liée à un ancrage quelque part. Il a donc fallu faire un tour chez les nomades, désapprendre que la sédentarité était la condition normale de la vie sociale, pour retrouver ce qui était caché après quelques millénaires d’exercice du pouvoir par le contrôle du mouvement.
Dans, sur, avec : les prépositions que nous pouvons utiliser pour exprimer la spatialité des sociétés (leur mode d’existence spatiale), importent plus qu’il n’y paraît.
Si les sociétés vivent dans l’espace, c’est dans un environnement, un milieu, un « bocal » qui leur procure ressources et caractères, un attachement aussi, à la terre et ce qu’elle porte là : le territoire. Si le milieu change de propriétés biophysiques, mais aussi sociales et politiques, il peut être nécessaire de pousser plus loin sa tente : c’est un déplacement. La géographie la plus classique était fondée sur cette observation des relations des hommes à leur milieu.
Si les sociétés vivent sur l’espace, la surface terrestre devient plane. Toujours marquées par les qualités différenciées des milieux, les sociétés sur l’espace s’agencent spatialement selon un dispositif hiérarchique de centres et de périphéries, répété à toutes les échelles dans la régularité des lois dérivées de la gravitation : la masse divisée par la distance désigne la capacité d’organisation (polarisation), étant entendu que les localisations sont fixes mais peuvent varier dans leur capacité à polariser.
Dans les deux cas, du milieu ou de l’espace comme surface de transport (c’est ainsi que l’espace géographique abstrait est qualifié), nous pouvons remarquer que l’explication des sociétés à travers leurs lieux se trouve à l’extérieur d’elles-mêmes, dans la nature qui s’impose par ses lois. Qu’il s’agisse de la nature biophysique de la surface terrestre ou des lois naturelles de la gravitation, de l’espacement et de l’équilibre, le déterminisme joue à plein régime, et la cause peut alors être recherchée de même qu’éventuellement les adaptations humaines qui en adoucissent les effets. Il n’est de science positive qu’à la condition de cette expulsion de l’explication vers l’extérieur.
Mais si les sociétés n’existent qu’avec l’espace comme une de leur dimension constitutive, par le réglage des distances qui rapproche ou éloigne, par la mise au point de normes rendant possible la cohabitation, ou l’empêchant, il nous faut observer à l’intérieur d’elles et dans leurs relations ce qui nécessite et permet ce réglage : tout simplement du mouvement. Rapprochement, éloignement, il n’y a pas de société spatialement identifiable sans le mouvement. Même l’idée de mobilisation des identités collectives y ramène !
Pourquoi faut-il alors passer à un autre espace de représentation ? L’espace mobile présente cette faculté méthodologique de ne pas poser d’abord des localisations pour observer ce qui est là. A l’inverse, il permet d’envisager que ce qui s’y passe c’est le croisement de ce qui y passe. Le « y » désigne le lieu qui se produit ; ce peut être ici ou là, la qualité du lieu est liée à l’entrée en corrélation réciproque des mouvements qui se croisent. Nous pouvons en reconnaître le site (là où « cela » se passe, et il est possible que le site soit en lui-même attractif) ; nous pouvons et devons même reconnaître que des sites ont fait l’objet d’investissements pour accueillir plus commodément les mouvements, devenant ainsi des localités avec de l’épaisseur patrimoniale gardée en souvenir et passée de génération en génération. Mais cela ne fait lieu qu’à la condition que le mouvement continue. Et parfois, c’est ailleurs que le croisement se produit : le lieu peut se déplacer. Il se fait et se défait sans cesse : il est éphémère, un même site pouvant accueillir des lieux différents selon le moment du jour et de la nuit, de la semaine, de l’année... La distinction du site, de la localité et du lieu est nécessaire.
Nous avons tous conscience que la distance sépare et c’est tout. Nous nous donnons les moyens de la réduire et nous faisons du lieu ; nous nous efforçons de l’augmenter ou de la tenir et nous faisons de l’espace. Le lieu n’est pas un espace de petite dimension. Il est là où la distance est annulée. Mais il ne peut rester isolé du mouvement au risque de perdre son énergie. Le mouvement doit continuer de sorte que la convergence qui annule la distance se transforme en divergence. Le terre étant ronde, la divergence conduit fatalement à la convergence et ainsi de suite. La limite c’est l’horizon qui fuit devant et s’ouvre à l’arrière. Rien à voir avec l’espace borné et bordé du monde des sédentaires cloisonnés. Chez les nomades cette infinie possibilité des lieux était la condition de la survie. Nul doute que la mobilité généralisée qui anime le monde contemporain, serait mieux comprise avec cet espace de représentation.
Cette mobilité généralisée dont il est fait grand cas, doit cependant faire elle-même l’objet d’un examen serré. Générale certes, mais inégale, la « capacité mobilitaire » n’en reste pas moins un signe de pouvoir. Alors que ce pouvoir de contrôler le mouvement était masqué par la terre, celle de l’investissement foncier, et par la pierre, celle des monuments à et de façade, voilà que tombent les masques. Pour pouvoir être partout chez soi, chez les nomades d’antan comme chez ceux de la jet society d’aujourd’hui, il faut que les sites d’accueil soient entretenus ; il faut que quelques astreints à résidence demeurent là, servilement, en attendant que la saillance éclate et que la lumière éclaire le lieu pour un temps de gloire. Si l’accès à la mobilité ne libère pas beaucoup plus que l’accès à la propriété, il n’en ouvre pas moins de plus vastes horizons que celui du cloisonnement. Les migrants et nomades seront donc toujours sévèrement contrôlés.
Sommaire du numéro 4
--------------------
EDITO JOURNAL À TITRE PROVISOIRE N°4 : MAKHNOVTCHINA / EXPULSÉE PAR LE CADASTRE, UNE AUTRE VILLE : MOBILE--------------------
DES ENCLAVES NOMADES DE FAIT ! ROUEN QUAIS RIVE GAUCHE : TRAVELLERS, FORAINS, OUVRIERS DE LA CATHÉDRALE, CAMPING CARISTES.
« ESPACE MOBILE »
DE LA FOIRE AU LOGICIEL LIBRE : ALLERS ET RETOURS PAR ARNAUD LEMARCHAND
HOMMES DES CAVERNES, TRAVAILLEURS NOMADES, MANOUCHES ET RETRAITÉS
RUBRIQUE NOIRE DU CAFÉ MAGIQUE À L'INSTANTANÉ VOYAGEUR
MKN-VAN ATELIER MOBILE, CARAVANE OUTIL
NOMADISME ET MÉTROPOLE REJET, DÉTOURNEMENT ET RÉCUPÉRATION
LE NIGLOBLASTER, RÉPONSE À L'IMPOSSIBLE CARTOGRAPHIE DE LA MOBILITÉ